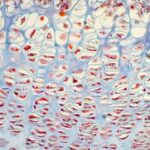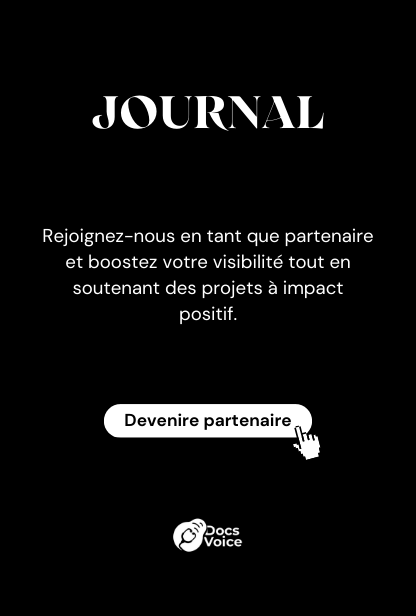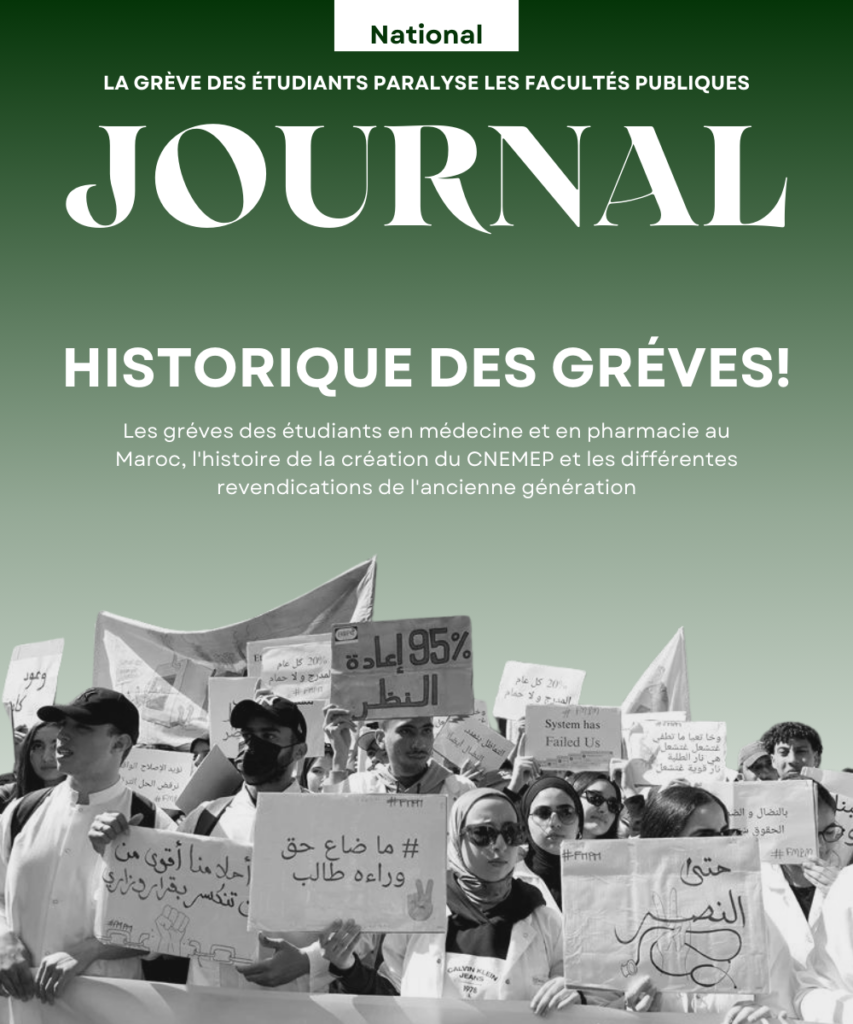En 2010, le Maroc a obtenu le certificat d’élimination du paludisme délivré par l’OMS après quatre décennies de lutte. Cependant, malgré ce succès, le risque de réémergence de la maladie demeure probable.
Devant l’ouverture du pays vers l’international, et l’accroissement des mouvements de la population entre le Maroc et les différents pays d’Afrique subsaharienne, notamment les pays endémiques , tels que la Côte d’ivoire, le Mali ou le Sénégal. Le risque de récidive indigène du paludisme persiste .Cette menace est loin d’être une hypothèse spéculative, d’autres pays comme l’Algérie en 2012 et la Grèce en 2007 ont connu un retour de la maladie après des années d’élimination.
Pour se prémunir d’un tel scénario, le ministère de la santé a initié une mise à jour du plan national de prévention de la réémergence du paludisme 2025-2030, en synchronisation avec les Objectifs du développement durable et la stratégie technique mondiale de l’OMS, qui visent à éliminer le paludisme d’ici 2030 .Ce plan vise à :
– Prévenir la réémergence du paludisme autochtone au Maroc ;
– Détecter précocement les cas suspects ;
– Réagir rapidement à toute transmission locale.
Néanmoins, divers obstacles entravent l’exécution efficace de cette stratégie .
Manquement au protocole de déclaration .
Bien que le paludisme soit une maladie à déclaration obligatoire, des sources internes à la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies (DELM) affirment que tous les cas de paludisme ne sont pas systématiquement signalés. Cette dérive revient essentiellement au fait que la non déclaration n’est pas pénalisée. Pour y remédier , la DELM a mis en place une procédure qui dicte que la déclaration devient obligatoire avant toute délivrance des traitements antipaludiques.
Retards diagnostics .
“Toute fièvre inexpliquée chez une personne revenant d’une zone endémique est un paludisme jusqu’à preuve du contraire”. Cette consigne essentielle se trouve entravée par une partie des médecins traitants. Ces derniers, en considérant le paludisme comme un diagnostic différentiel secondaire , mènent à des retards de diagnostics, par conséquent a une accrétion de risque de complications.
Obstacles culturels et éthiques
Des difficultés liées à la gestion des patients étrangers ont également été signalées. En effet, l’absence de prise en compte de l’habitude nutritionnelle des malades étrangers pose souvent problème. Le changement brutal de régime alimentaire des étrangers hospitalisés, peut mener à des symptômes souvent attribués à tort au paludisme. En outre, les atteintes aux règles éthiques en matière de respect de la confidentialité, d’accès équitable au traitement, et de justice sanitaire, restent un point de préoccupation.
Limite des outils de diagnostic .
Le Maroc de nos jours reste tributaire de méthodes classiques de diagnostic : goutte épaisse, frottis mince et tests de diagnostic rapide (TDR). Cette dépendance aux méthodes traditionnelles nous condamne à un retard constant de diagnostic , et à une persistance du paludisme.
A cela s’ajoute le défaut de personnel qualifié. Certaines régions souffrent toujours d’un manque de microbiologistes compétents, ce qui compromet la qualité du diagnostic.
Une coordination intersectorielle à renforcer .
La GILAV (Gestion Intégrée de Lutte Anti-Vectorielle) est un programme dont l’objectif principal est de contribuer à la réduction du risque de transmission des maladies à transmission vectorielle, en l’occurrence le paludisme. Ce programme repose sur la coordination de quatre ministères : Santé, Intérieur, Agriculture, et Environnement. Cependant, Bien que ce dispositif existe, la coordination entre différents acteurs reste faible, avec des réunions parfois irrégulières et une absence de reporting standardisé, ce qui entrave l’efficacité du programme.
Malgré la faible incidence du paludisme au Maroc à l’heure actuelle, ce dernier reste exposé à un risque constant de réémergence. L’application rigoureuse du plan de riposte proposé reste déterminante et essentielle pour éviter le retour de ce fléau.